Dežurni telefon: +381 61 63 84 071
Un pont entre deux cultures

Rima Kilani est la première médiatrice culturelle en Serbie, travaillant pour le compte de l’ONG Atina à la frontière avec la Croatie. Pour occuper ce poste, il faut être ouvert d’esprit, honnête et perspicace, autant de qualités incarnées par la personnalité positive de Rima, qui rayonne de confiance et d’assurance. Nous partageons ici sa perspective sur ce poste et sur la crise des réfugiés en général.
Pouvez-vous expliquer ce qu’est la médiation culturelle ?
La médiation culturelle est différente de la traduction. Il s’agit de créer un pont entre deux cultures, et pas seulement entre deux langues. Il est essentiel pour un médiateur culturel de comprendre et de connaître les deux cultures, car lorsqu’on traduit ou interprète un sujet, il faut adapter non seulement l’idée, mais tout le concept à la culture vers laquelle on traduit. Bien sûr, il existe des critères importants pour les médiateurs culturels – certains sont personnellement difficiles à respecter – il faut être totalement sincère et honnête dans la transmission des idées. Il faut être loyal envers la culture, mais pas imposer sa propre perspective, sinon cela devient très difficile. Il faut traduire et adapter, sans imposer sa personnalité.
Dans le contexte de la crise des réfugiés, le rôle de médiateur culturel est-il important ?
Dans cette situation, ce poste est crucial pour établir la confiance entre les travailleurs sur le terrain et les personnes dans le besoin. Les moments les plus marquants sur le terrain sont souvent ceux où tout doit se faire rapidement. Pour clarifier une idée, il faut un certain temps pour établir une petite communication de confiance entre trois personnes : moi, la personne dont je traduis les paroles, et la personne à qui je traduis. Traduire les mots ne suffit pas ; en peu de temps, il faut gérer le langage corporel, le contact visuel et le concept, parfois dans des conditions difficiles : on est pressé, ou la personne est frustrée ou en colère, ou l’organisation a d’autres préoccupations. Transmettre correctement l’idée devient délicat. Ce n’est pas comme être chez soi et tout transférer tranquillement, c’est un travail sous pression. Il faut être précis et compréhensif. Sur le terrain, la tension est élevée, pas tout le temps, mais lorsque la crise atteint son apogée, même si les gens savent que cette tension passera, cela reste intense.
Comment ce poste affecte-t-il votre vie personnelle ?
Il m’a appris à ne pas juger hâtivement. J’observe comment les gens se jugent mutuellement lorsqu’il y a un malentendu, et cela arrive même entre personnes parlant la même langue. Cela m’enseigne à réfléchir, à interpréter différemment et à considérer plusieurs aspects avant de juger.
Au début, il était parfois difficile d’atteindre les femmes, qui restaient souvent en retrait tandis que les hommes étaient en avant. Quelle a été votre expérience ?
Cela ne s’applique pas à toutes les cultures avec lesquelles je travaille. Personnellement, il m’est plus facile de parler aux femmes, car la relation femme à femme crée un climat de confiance. Les femmes venant de villages ou de banlieues préfèrent rester en retrait et laisser les hommes parler. Avec les Afghanes, il était vraiment difficile d’atteindre les femmes. Les réfugiés viennent de cultures très diverses – plus de 80 millions de personnes si l’on compte toutes les cultures générant des réfugiés. Mon âge et le fait que je sois femme facilitent la relation de confiance avec les femmes.
Voyez-vous que ce parcours transforme les relations entre les personnes et les cultures ?
Au début, ce n’était pas le cas, mais environ depuis la deuxième année de la crise, les choses ont changé. Beaucoup d’hommes ont été recrutés ou tués, donnant un rôle plus important aux femmes. Elles doivent travailler, prendre des décisions, diriger. Ces derniers temps, nous voyons beaucoup de femmes voyager seules, pour sauver leurs enfants ou elles-mêmes. Avant, elles étaient plus soumises et réservées, mais désormais, elles doivent être fortes car le soutien n’est pas garanti.
Quelles sont vos attentes pour cette situation ?
Personnellement, je pense qu’un miracle serait nécessaire ; je ne vois pas de solution rapide. Le problème grandit, et les pays qui pourraient intervenir ne font rien. Cela prendra du temps. Les réfugiés continueront à arriver, cherchant à fuir malgré les difficultés. Beaucoup ont perdu espoir après cinq années de guerre, mais espèrent encore trouver un moyen de partir.
Et pour ceux qui ont atteint leur pays de destination ?
Certains jeunes poursuivent leurs études et peuvent repartir à zéro, mais beaucoup rencontrent des difficultés – choc culturel, mauvaises expériences, attentes élevées non satisfaites. Certains doivent travailler pour payer l’évasion du recrutement obligatoire. Si un endroit sûr existait dans leur pays d’origine, plus de 70 % y retourneraient.
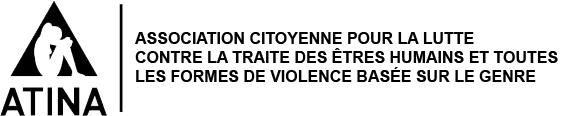

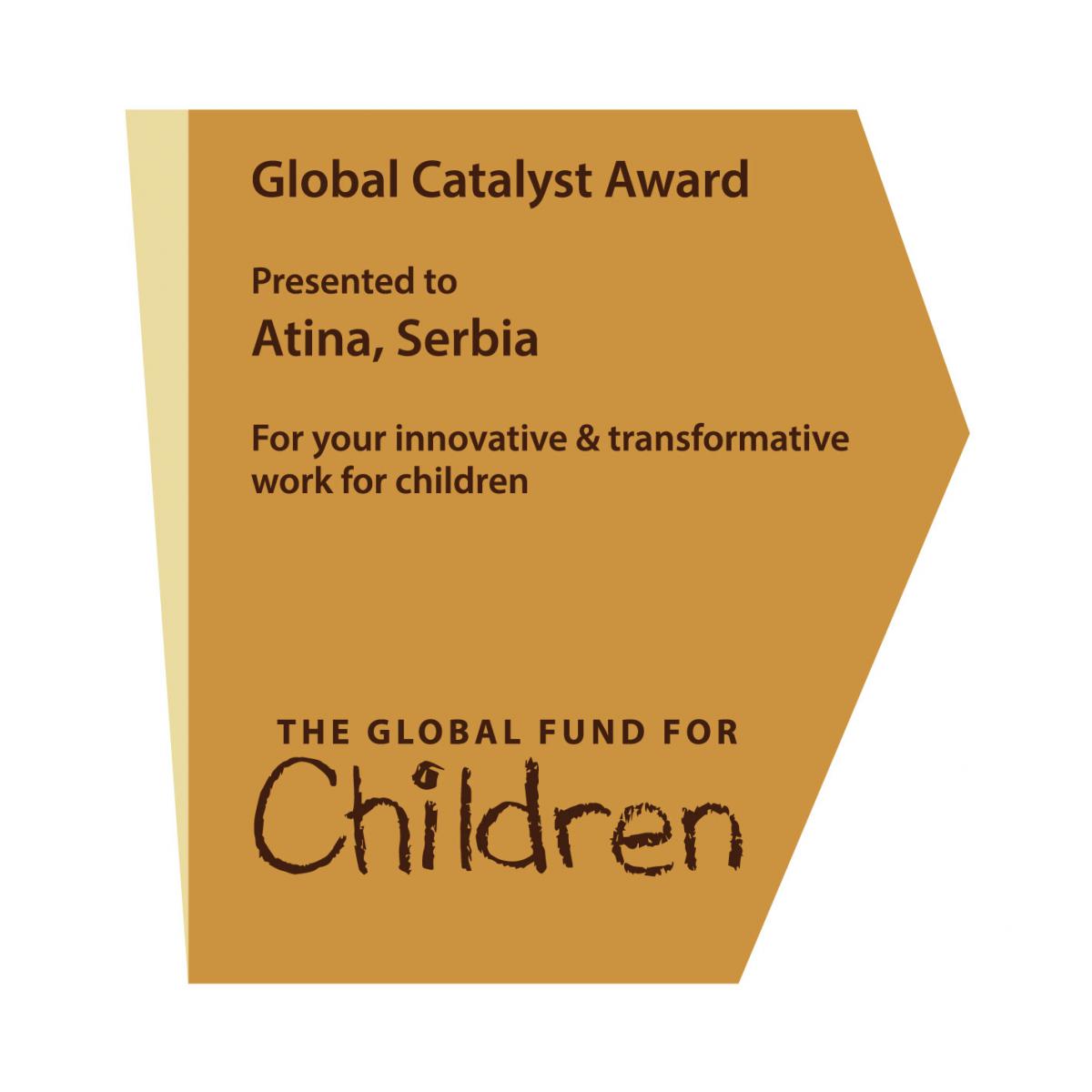







 FACEBOOK
FACEBOOK TWITTER
TWITTER YOUTUBE
YOUTUBE